|
Les
Arméniens sont d’origine indo-européenne et de
confession chrétienne. Ils occupèrent dans
l’Antiquité, en partant d’une implantation
autour du lac de Van (actuelle Turquie), une
aire géographique étendue de la Caspienne au
Caucase, la Grande Arménie, qui incluait
l’Azerbaïdjan actuel.
Après la chute de son royaume sous le choc
des armées de Pompée, l’histoire de l’Arménie,
prise entre les rivalités des grands empires
rivaux, romain, parthe, byzantin, arabe,
ottoman, persan, russe, est une succession de
phases d’indépendances, de dépendances et de
partages.
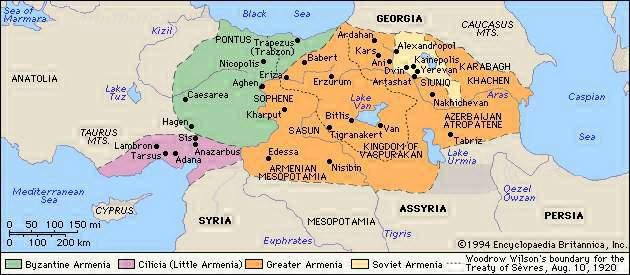 L’expansion russe au Caucase (à partir de la
fin du XVIIIe siècle) et le génocide des
Arméniens de Turquie en 1915 situent
définitivement le centre de gravité du pays à
l’Est du fleuve Araxe, dans le Caucase. La
région arménienne de l’Empire russe est
instaurée en 1828. L’expansion russe au Caucase (à partir de la
fin du XVIIIe siècle) et le génocide des
Arméniens de Turquie en 1915 situent
définitivement le centre de gravité du pays à
l’Est du fleuve Araxe, dans le Caucase. La
région arménienne de l’Empire russe est
instaurée en 1828.
Elle est remplacée par une vice-royauté du
Caucase divisée en plusieurs gouvernements,
dont celui d’Erevan qui forme la base
territoriale de l’actuelle Arménie.
Dans ce territoire, les Arméniens ne
deviennent majoritaires qu’en 1914. Lors de la
Révolution russe, l’Arménie accède à une
éphémère indépendance et finit par être
soviétisée à la suite de difficultés de toutes
sortes et de considérations diplomatiques et
géopolitiques.
L’Arménie devient la cinquième république
soviétique le 29 novembre 1920
De 1922 à 1936, elle est une des républiques
de la Transcaucasie, avec la Géorgie et
l’Azerbaïdjan.
En 1936, l’Arménie devient une République
socialiste soviétique (RSS) à part entière.
La RSS d’Arménie est la plus petite des 15
républiques soviétiques. Elle est enclavée,
entourée par la Turquie, la Géorgie,
l’Azerbaïdjan et l’Iran.
C’est la plus densément peuplée.
Bien
que son peuplement soit très homogène (89,7%
d’Arméniens, 5,3% d’Azéris, 2,3% de Russes,
1,7% de Kurdes), de nombreux Arméniens
vivaient dans d’autres républiques du Caucase
: en Transcaucasie (140.000 dans le
Haut-Karabagh, 540.000 en Azerbaïdjan, 455.000
en Géorgie, puis en Adjarie1
(172.000) et au Turkménistan (quelques
milliers).
Les Arméniens sont donc en contact, sur
différents territoires, avec les Azéris,
autrefois appelés Tatars, issus d’anciens
peuples du Caucase, de langue turque et de
religion musulmane chiite.
La question du Haut-Karabagh
La question nationale arménienne est demeurée
non résolue du temps de l’URSS.
En témoignent les mutilations territoriales
du pays et l’ampleur de sa diaspora (moins de
la moitié des 6 à 7 millions d’Arméniens
vivent dans la République d’Arménie). Elle
s’est focalisée sur la question du
Haut-Karabagh (Artsakh en arménien).
 Le Karabagh est généralement considéré comme
ayant fait partie de la Grande Arménie de
l’Antiquité. Toutefois, certains historiens
affirment qu’il faisait en réalité partie d’un
royaume chrétien aujourd’hui disparu,
l’Albanie du Caucase. Le Karabagh est généralement considéré comme
ayant fait partie de la Grande Arménie de
l’Antiquité. Toutefois, certains historiens
affirment qu’il faisait en réalité partie d’un
royaume chrétien aujourd’hui disparu,
l’Albanie du Caucase.
Cette région a en tout état de cause adopté
la chrétienté arménienne et, du fait de
l’importance du facteur religieux, la
population albanaise (à ne pas confondre avec
les Albanais d’aujourd’hui) et la population
arménienne se sont mêlées sur ce territoire,
conduisant, au VIIe siècle à la disparition
d’une identité albanaise distincte.
Le Karabagh fut ensuite occupé par les
Arabes, les Mongols, les Turcs, les Iraniens
et les Russes. Des Arméniens en provenance de
Turquie ont été réinstallés dans cette région
et alentour par les Russes au début du XIXe
siècle, notamment afin de créer une zone
tampon peuplée de chrétiens entre les Azéris
du Caucase et ceux de Turquie et d’Iran.
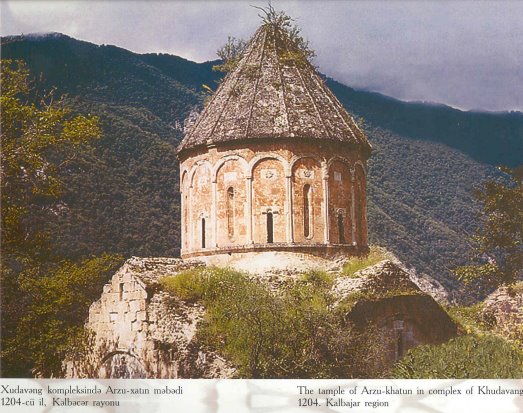
Ainsi se constitue, en Transcaucasie, une
zone de peuplement mixte Arméniens-Azéris. Les
Arméniens s’installent dans les villes
(Erevan, Chouchi,
Tbilissi, Bakou) et cohabitent d’abord
pacifiquement avec les paysans musulmans.
L’équilibre se rompt après les massacres
d’Arméniens en Turquie en 1895. Les partis
politiques arméniens se créent et se
développent.
Lors de la première révolution russe de 1905,
des affrontements ont lieu, suscités soit par
des chefs locaux Tatars, soit par les
autorités tsaristes.
Ripostes et contre-ripostes engendrent
émeutes et massacres.
Il y aura des milliers de morts, Azéris et
Arméniens. C’est ce qu’on appelle la «guerre
arméno-tatare ».
Elle prend fin en 1906 et laisse à chaque
communauté le sentiment d’avoir été persécutée
par l’autre. Elle favorise la montée en
puissance du parti Dachnak, leader de la
guerre anti-azérie et fer de lance de la
révolution dans le Caucase.
Vient ensuite le génocide en Turquie et
l’arrivée d’Arméniens pour qui les Azéris ne
sont rien de moins que les frères de leurs
oppresseurs, parlant la même langue et ayant
la même religion.
Les affrontements seront dès lors fréquents
entre les deux populations.
De 1918 à 1920, les républiques indépendantes
d’Arménie et d’Azerbaïdjan se sont disputé le
contrôle du Karabagh, pour des raisons
symboliques et stratégiques.
Des pogroms et des incendies anéantissent le
quartier arménien de Chouchi en février 1920.
Cette même année, Erevan accepte de se
joindre à l’Union soviétique à condition que
le Haut-Karabagh soit intégré à l’Arménie.
Cette promesse n’est tenue que jusqu’en 1921
par Joseph Staline, le Commissaire aux
nationalités de l’époque ; l’URSS avait besoin
du soutien de la Turquie, favorable au
rattachement du Karabagh à l’Azerbaidjan, et
de l’équilibre des forces à l’intérieur de
l’Union, le Haut-Karabagh, peuplé en grande
majorité d’Arméniens, revient à l’Azerbaïdjan.
C’est ainsi que la RSS d’Azerbaïdjan avait
deux territoires formant des sous-divisions:
une RSSA (le Nakhichevan, autrefois partie de
la Grande Arménie et enclave azérie en
Arménie) , et une RA (le Haut-Karabagh,
enclave arménienne d’environ 4400 km² en
Azerbaïdjan, au sud-ouest de Bakou, séparée de
l’Arménie par une étroite bande de terrain à
peine large de 10 kilomètres).
Le Haut-Karabagh avait cinq zones
administratives : Askeran ( parfois appelé
Askaran), Hadrout (ou Gadrut ou Gadrout),
Martakert (ou Merakert), Martouni ( ou Martuni)
et Chouchi.
La
guerre du Haut-Karabagh
Les Arméniens soulignent que des violences ont
eu lieu contre eux au Karabagh soviétique
notamment en 1929 et 1964. Ils relèvent des
discriminations culturelles croissantes
relayées par un mouvement pro-turc en
Azerbaïdjan et de fait les tentatives
d’assimilation répétées du gouvernement azéri
ont provoqué le mécontentement, par ailleurs
encouragé par le nationalisme arménien.
La première pétition réclamant le
rattachement du Haut-Karabagh à l’Arménie a
été adressée à Khrouchtchev le 19 mai 1963 par
2500 Arméniens de la région autonome. Par la
suite, un courant politique fort en Arménie
soutient cette revendication, fondée sur le
droit à l’autodétermination, un courant
inverse se développant en Azerbaïdjan, fondé,
tout comme le refus des autorités soviétiques,
sur l’intangibilité des frontières.
Le mouvement s’accentue avec la
perestroïka, les Arméniens manifestant
notamment contre la mainmise de plus ne plus
forte de Bakou sur le Karabagh.
En février 1988, 100.000 manifestants
défilent à Erevan pour demander le
rattachement à l’Arménie et il se crée à
Erevan un Comité Karabagh, formé
d’intellectuels.
Le 20 février 1988, le Soviet suprême du
Haut-Karabagh adopte une résolution demandant
le transfert de la région à l’Arménie.
Le 28 février 1988, à Soumgaït (banlieue de
Bakou), des Azéris se lancent dans un
véritable pogrom contre des civils arméniens.
Le bilan est de 32 morts parmi les Arméniens.
La majorité des 18.000 Arméniens résidant à
Bakou s’enfuient.
Des affrontements ont également lieu dans les
zones rurales entre Arméniens et Azéris.
Dès lors, l’Arménie expulse sa population
azérie à partir de d’automne 1988.
En 18 mois, presque tous les 195.000 Azéris
d’Arménie sont expulsés ainsi que 300.000
Arméniens d’Azerbaïdjan.
Pour en savoir plus : voir le livre :
http://www.armenews.com/IMG/Ex-URSS_-
situation_des_refugies_et_deplaces_d_origine_armenienne_sur_le_territoire_de_l_ex-Union_sovietique_1_.pdf
Bibliothèque d’ouvrages parus en France :
http://www.imprescriptible.fr/archives/france/index_10_fr.htm
Dès novembre 1988, le Comité Karabagh appelle
à la constitution de milices et de groupes
d’autodéfense en réaction à ces pogroms. La
principale milice, l’Armée nationale
arménienne, fondée en 1989 par Razmik Vasilyan,
regroupait 6000 hommes appelés Fedayi
(combattants).
Il s’agissait de volontaires, essentiellement
recrutés dans le Haut-Karabagh, encadrés par
d’anciens vétérans de la guerre d’Afghanistan
et d’une partie des 40.000 militaires
d’origine arménienne servant dans l’ex-armée
rouge.
Une Commission spéciale d’administration du
Karabagh est mise en place par les autorités
soviétiques en janvier 1989. En août 1989,
l’Azerbaïdjan isole le Karabagh.
En réponse, l’Arménie sabote les voies de
communication entre l’Azerbaïdjan et le
Nakhitchevan. Le blocus azéri, fait avec
l’aide de la Géorgie, est cependant le plus
efficace et il paralyse l’Arménie. Le
Parlement arménien déclare l’union du Karabagh
et de l’Arménie le 1er
décembre.
En réponse, des attaques azéries ont lieu sur
les districts de Xanlar (ou Khanlar) et
Chaoumian (Shaumyan en azéri ), contre des
villages arméniens.
Les négociations échouent et les 13 et 14
janvier 1990, la communauté arménienne de
Bakou est frappée par un autre pogrom. L’état
d’urgence est décrété et l’armée soviétique
intervient, officiellement pour restaurer
l’ordre et sauver des vies arméniennes. Bakou
est bombardée.
Ce mois de janvier, dit «janvier noir » fait
170 morts, 370 blessé et 321 disparus. Le
Parlement azéri supprime le statut d’autonomie
du Karabagh en août.
En janvier 1991, le parlement azéri dissout le
district arménien de Chaoumian et l’annexe
àcelui de Kassum-Ismailov. Les premiers
mouvements de population ont lieu au printemps
1991 quand les troupes azéris déportent les
habitants de 24 villages arméniens des
districts de Chaoumian, Xanlar, Hadrut et
Choucha.
Environ 10.000 d’entre eux devront fuir,
essentiellement vers d’autres villes et
villages du Haut-Karabagh.
En août est déclarée l’indépendance de
l’Azerbaïdjan. En septembre le Haut-Karabagh
et le district dissous de Chaoumian déclarent
leur indépendance à l’égard de l’Azerbaïdjan.
Les frontières de ce nouvel Etat
correspondent à celles du Karabagh et de
Shaumyan.
Des bombardements commencent depuis les
secteurs azéris. La tentative d’administration
directe soviétique a duré jusqu’en novembre
1991.
Le coup d’Etat en Russie en août 1991, suivi
des déclarations d’indépendance sonnent le
glas de l’URSS.
Le 10 décembre 1991, les Arméniens organisent
un référendum au Haut-Karabagh sur
l’indépendance et celle-ci est déclarée le 6
janvier 1992.
Le 29 février les forces russes reçoivent
l’ordre d’évacuer la région.
Une offensive militaire azérie est lancée
début février 1992. Appuyés par des
bombardements, des centaines de militaires et
quelques blindés avancent dans l’enclave, à
partir du nord.
Les forces d’auto-défense du Haut-Karabagh
ripostent avec l’aide d’une division
d’infanterie russe. Elles prennent Chouchi le
8 mai et le corridor de Latchine (ou Lachin)
le 18 mai afin de briser le blocus. Ces
offensives conduisent au déplacement hors du
Karabagh de la quasi totalité de la population
azérie notamment des villes de Chouchi,
Khodjaly et Latchine.
Une contre-offensive azérie en juin reprend
près de la moitié du Karabagh et déplace 50 à
70.000 Arméniens sur Stepanakert. La
mobilisation générale est décrétée en août
dans le Haut-Karabagh.
 Durant l’année 93, les forces de défense du
Haut-Karabagh, armée régulière organisée cette
même année par le Comité de défense avec les
fedayi des anciennes milices,
reprennent les territoires conquis par
l’Azerbaïdjan puis s’engagent en territoire
azéri, après la prise de la ville de Kelbadjar
(3 avril). Durant l’année 93, les forces de défense du
Haut-Karabagh, armée régulière organisée cette
même année par le Comité de défense avec les
fedayi des anciennes milices,
reprennent les territoires conquis par
l’Azerbaïdjan puis s’engagent en territoire
azéri, après la prise de la ville de Kelbadjar
(3 avril).
Des centaines de milliers de personnes fuient
les combats.
En juillet et septembre, les forces
arméniennes du Haut-Karabagh prennent Agdam,
Fizuli et Jebrail, occupant ainsi des
territoires azéris adjacents du Haut-Karabagh
et forçant au déplacement environ 600.000
Azéris. La contre-offensive azérie est un
échec.
L’arrêt des combats a été obtenu par les
Russes en mai 1994.
Le cessez- le- feu est toujours en vigueur et
il n’y a plus que quelques escarmouches dans
les zones frontalières.
Cependant la paix n’est pas signée, aucun
accord n’ayant encore été trouvé sur le sort
du Haut-Karabagh, république autoproclamée,
non reconnue sur le plan international.
La plupart de ceux qui ont été expulsés du
Haut-Karabagh y sont revenus à la faveur des
victoires arméniennes.
Entre 1988 et 1994, les Azéris ont été 167.000
à être chassés d’Arménie, 40.000 du
Haut-Karabagh et entre 480.000 et 530.000 à
être déplacés de sept autres provinces
occupées désormais par l’Arménie. La vague la
plus importante a eu lieu en 1993, avec
l’offensive sur Lachin et les provinces de
Kelbadjar, Agdam, Fizuli, Jebrail, Qubatli et
Zangelan. Leurs maisons ont été pillées et
détruites.
II. SITUATION ACTUELLE
En 1996, on estimait que la majorité des
350.000 Arméniens ayant fui la violence
étaient en Arménie comme réfugiés et que les
750.000 Azéris, pour la plupart déplacés,
résidaient en Azerbaïdjan. Cependant, le HCR
estime qu’un nombre non définissable d’entre
eux se trouvaient en Russie ou dans d’autres
pays de l’ancienne URSS.
Les Arméniens d’Azerbaïdjan, majoritairement
russophones ont sans doute en nombre gagné la
Russie.
Cette arrivée était, pour la Russie, le
premier flux de réfugiés depuis la Seconde
guerre mondiale.
Une partie enfin a quitté la CEI.
|