
Extrait
d’un vieux recueil de chants « ARARAT » de
Meguerditch Barsamian
Les chants
populaires arméniens
Depuis les
temps les plus reculés, le chant a présenté un
grand intérêt pour la médecine.
Sophocle, dans Oedipe Roi, témoigne que les
Grecs défilaient en chantant pour éloigner
les
épidémies.
Pindare dit qu'Askredbios soignait ses malades
en les environnant d'un bain de chants très
doux.
Platon
affirme que sans chants, les médicaments ne
font aucun effet.
Plutarque rappelle que Tarétas de Crète,
musicien, a sauvé les Spartiates de la peste
grâce à la
musique.
Théophrase écrit que la sciatique se soigne
avec de la musique prussienne.
Enfin,
d’après la Bible, David, avec sa musique,
avait soigné la mélancolie de Saül.
(Tous
les Psaumes écrits par David sont chantés,
parfois même accompagnés d’instruments à
corde. Ndt)
Sans doute,
ces témoignages ne sont -ils que des légendes,
mais depuis les temps les plus anciens de
l'histoire, les peuples savaient que la
musique ou le chant avaient une importante
influence sur l'état des êtres vivants, c'est
une vérité qui est reconnue jusqu'à ce jour.
Plutarque,
musicien, Aristotèle, Athénéos, accordent une
très grande efficacité à la musique, non
seulement sur le moral mais aussi sur les
capacités physiques.
Homère dit que les soucis se dissipent et le
caractère s'améliore.
Plutarque raconte que la musique ionnienne
était si molle, si dépourvue de fantaisie, si
douillette,
qu'un
musicien ionien Dimothéos, avait été
accueilli par des sifflets de mépris à
Athènes.
Mais chez
les
Lacédémoniens il a été prouvé qu'elle
détériore le caractère des jeunes gens, en les
rendant faibles, et en tuant leur âme virile,
si profonde est l'influence de la musique sur
eux.
En vérité, un
chant national suisse provoquait une telle
nostalgie, que dans l'armée française, les
volontaires pour s'inscrire, lorsqu'ils
entendaient ce chant, s'échappaient, quitte à
affronter tout danger.
Les Grecs
reconnaissaient que tout air de musique (ils
avaient divisé la musique en 4 parties) avait
une
action
particulière sur leur âme. Les airs prussiens
leur inspiraient fureur et courage, d’autres
airs, l’amour, ou tristesse et soupirs, ou
soulagement et méditation .
Platon, pour
comprendre le caractère et le tempérament d'un
jeune homme, disait: Parle, pour que je te
voie !
Le docteur
Etienne St-Marie, écrit dans les notes qu'il a
jointes à Roger pour la traduction de son
ouvrage :
« Traité des effets de la Musique sur le corps
humain « (p.263): quelqu'un qui a l'oreille
fine peut comprendre les aptitudes morales, le
comportement, le caractère des individus.
Et se souvient de quelqu’un qui déclarait :
« quand on me dit: Bonjour Monsieur, ces deux
mots me suffisent pour comprendre ses
prétentions - la politesse peut couvrir
l'homme derrière ses paroles, mais elle ne
peut pas le couvrir derrière la sonorité de
ses déclarations.
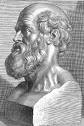 Enfin,
Hypocrate, en écoutant la voix, découvrait les
troubles de la santé. Enfin,
Hypocrate, en écoutant la voix, découvrait les
troubles de la santé.
Outre la
pathologie, la psychologie influe sur les
nuances de la voix, elle peut s’évanouir
brusquement sous l’influence de la peur. La
joie la remplit, l’admiration l’allonge.
Le climat
aussi influe sur la voix et sur les chants.
Les chants
populaires, qui ne sont pas les fruits de la
musique, mais l’expression des conditions du
climat, de l’originalité et le goût du pays.
C’est la
cause pour laquelle les émigrés, en entendant
ces chants, éprouvent une profonde mélancolie.
De même, les
chants populaires reflètent les gloires de la
population à laquelle ils appartiennent, ainsi
que leurs coutumes, leur histoire, leur
caractère, et même leur aptitude
intellectuelle et artistique, lorsqu’ils ont
étudié leurs possibilités vocales.
Les Grecs traduisaient par leur musique toute
leur civilisation, c’est pourquoi ils
considéraient comme barbares ceux qui ne
savaient ni chanter ni jouer de la musique.
Le théâtre
n’était pas seulement une distraction, mais un
événement public important. C’est pourquoi,
d’après le témoignage de Plutarque, les
Hellènes faisaient plus de frais pour leurs
représentations que pour la guerre contre
leurs ennemis.
Pour ces
représentations, ils se préparaient, avec tous
les soins possibles et impossibles pour leur
voix. On raconte qu’un jeune homme pour
adoucir sa voix, absorba une liqueur qui
s’avéra être un poison et causa sa mort.
Les acteurs
et chanteurs s’abstenaient de relations
sexuelles avant les fêtes pour que leur talent
soir à son summum.
En outre, la
musique joue un rôle décisif sur la
disposition spirituelle et la vie publique.
Tournons-nous
maintenant vers nos « hymnes » que nous
appelons « charagane » .
C’est toute
notre histoire qui repose en eux, toute notre
patrie.
Chanter
signifie se souvenir, et vivre son enfance, le
lieu de son enfance.
 L’un
des plus grands défenseurs de notre patrie,
Archag Tchobanian, disait avant la guerre : L’un
des plus grands défenseurs de notre patrie,
Archag Tchobanian, disait avant la guerre :
« Dans la
solitude, je chante un charagane, dans la
foule, je chante encore un charagane, mais en
pensée. »
C’est la
nostalgie de la patrie et de l’enfance qui
provoque cette « maladie ».
Chantez des
charaganes, car non seulement cela adoucit
votre peine d’être séparé de votre patrie,
mais aussi vous procure le goût de l’art.
Car, comme
l’écrit Gabriel Avédikian (‘Histoire
de la Poésie – Bruxelles 1886, p. 44 ) « Les
charaganes sont les plus précieux diamants de
notre culture musicale.
« Après les
charaganes, chantez nos chants traditionnels,
qui donnent le goût de l’arménité à ceux qui
l’ont perdu.
Shakespeare,
dans ‘Le Marchand de Venise’ écrit :
« L’homme qui n’a pas dans l’âme la mélodie
des voix et qui n’en est pas ému, est proche
de la tromperie, de la trahison, du vol ; ne
faites pas confiance en un tel homme. ».
Emplissez
donc votre âme de chants et de musique,
surtout de chants arméniens.
Chavarch
NARTOUNI
Traduction Louise Kiffer.
D’après
l’introduction du livre « ARARAT » , recueil
de chants arméniens de Meguerditch
BARSAMIAN . Imprimé à Paris
« Chavarch
NARTOUNI , (1898-1968) était né à Armache,
près de Constantinople.
Nartouni
(Ayvazian) avait fréquenté l’école du
village, ensuite le Guétronagan de la
ville d’Adapazar, enfin l’école militaire
de Constantinople d’où il fut exclu.
Il arrive en France en 1923 pour faire des
études médicales à Paris.
Médecin interne à l’hôpital psychiatrique
d’Amiens, Nartouni collabore très tôt à la
presse arménienne de Paris, fait partie,
jusqu’à sa mort, de la rédaction de
Haratch.
Il dirige l’Union des Arméniens de Paris,
fonde l’Union des Orphelins adultes dont
il dirige la revue ; ensuite, pendant de
longues années, il publie la revue
médicale, HAY POUJ, (médecin arménien).
En 1931, on le trouve à la tête de la
revue MENK. Sa signature apparaît dans
toutes les revues de la capitale, de
Zvartnots à Andastan.
Il meurt à Marseille. »
(Extrait
de ‘Cinquante ans de littérature en
France’ de Krikor Bélédian (CNRS
Editions).
|