|
Au début du 17ème
siècle la France possédait en Amérique
du nord un vaste territoire de
l’embouchure du fleuve St Laurent à la
vallée de Ohio jusqu’au delta du
Mississipi. Ce territoire s’appelait
« La Nouvelle France ». A l’époque, il
n’y avait pas de Français qui y
habitaient, seulement des pêcheurs et
des chasseurs, qui revenaient en France,
chargés de poissons et de fourrures.
Louis XIV voulut exploiter les
ressources du Nouveau Monde. Il fit
battre tambour, et des volontaire des
provinces de France acceptèrent de se
rendre dans la « Nouvelle France » .
Parmi eux, se trouvaient de nombreux
Bretons, et des Poitevins, qui
s’établirent dans la capitale Québec,
fondée par Champlain en 1608. Ils eurent
le temps de prendre racine dans
l’Acadie, de fonder un foyer et
d’améliorer leur situation. Mais en
1713, la France dût céder une grande
partie de sa colonie au Royaume Uni à
qui elle céda aussi 1700 habitants de
l’Acadie.
Les
Acadiens deviennent donc des sujets
britanniques. 400 soldats britanniques
restent sur place.
Les
Acadiens refusent de prêter au roi de
Grande-Bretagne le
serment
d’allégeance. La population
acadienne était passée de 1700 à 15 000
en 62 ans,
En
1754, la crise éclate. Le gouverneur
Charles Lawrence confisque les armes et
les embarcations et décrète
la DEPORTATION
des Acadiens au mois de juillet 1755.
« LE
GRAND DERANGEMENT »
 Les
Anglais voulaient prendre les fermes et
les terres des Acadiens qui étaient les
plus fertiles Tous les Acadiens devaient
être déportés sans exception. Ils sont
d’abord conduits dans différents
districts, au fort ou à l’église locale,
où ils sont encerclés, leurs maisons et
églises brûlées, puis arrêtés et détenus
dans des bateaux. Les
Anglais voulaient prendre les fermes et
les terres des Acadiens qui étaient les
plus fertiles Tous les Acadiens devaient
être déportés sans exception. Ils sont
d’abord conduits dans différents
districts, au fort ou à l’église locale,
où ils sont encerclés, leurs maisons et
églises brûlées, puis arrêtés et détenus
dans des bateaux.
Leurs possessions
allaient être confisquées par Sa
Majesté.
Lors de
leur déportation en
1755,
beaucoup d'Acadiens, alors détenus en
Angleterre, furent envoyés en France.
Dans l'attente d'un embarquement pour la
Louisiane,
certains patientèrent en
Bretagne et dans le
Poitou.
Ceux qui
n’avaient pas pu revenir en France
furent embarqués dans des navires en
provenance du Massachussetts. Les
déportés furent divisés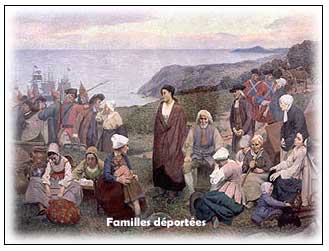 par groupes d’âge et de sexe et
éparpillés ( de 200 à 400 déportés dans
chaque bateau) le long de la côte
atlantique dans une vingtaine de villes
des Etats-Unis.
par groupes d’âge et de sexe et
éparpillés ( de 200 à 400 déportés dans
chaque bateau) le long de la côte
atlantique dans une vingtaine de villes
des Etats-Unis.
La
Virginie et la Caroline du Nord
refusèrent les 1500 Français. Les
Acadiens qui s’échappaient étaient
chassés, et souvent fusillés.
Les
survivants devaient errer sans résidence
et sans nourriture, même pendant les
durs hivers. Plus de 500 Acadiens
moururent à l‘hiver 1758.
Certains
furent abandonnés dans les Caraïbes.
Plusieurs se réfugièrent en Louisiane
pour devenir les premiers Cajuns.
Charles
Lawrence ordonne à ses hommes :
«Vous devez faire tous les efforts
possibles pour réduire à la famine ceux
qui tenteront de s’enfuir dans les
bois ».
Aux
Etats Unis ils furent généralement mal
reçus car ils n’étaient pas Protestants.
On les appelait les Papistes. De plus,
ils ne s’intégraient pas dans le moule
américain (le melting pot) ils voulaient
conserver leur langue, leurs coutumes et
traditions. Ils étaient très malheureux,
mal logés, souvent sans travail.
Plusieurs enfants furent arrachés à leur
famille pour être placés en adoption
dans des familles anglo-méricaines.
Sur une
population totale évaluée entre 12 000
et 18 000 Acadiens en
1755, de 7 500 à 9 000
périrent, soit des effets de la
déportation, soit en tentant d'y
échapper.
Belle-Île-en-Mer
était occupée par les Britanniques, mais
le
traité de Paris (10
février
1763), qui donnait le
Canada
aux Britanniques, a permis à la
France de récupérer
Belle-Île. Un mois plus tard les
Acadiens prisonniers en
Grande-Bretagne
sont libérés et viennent grossir le
nombre des réfugiés dans les ports
français.
La même
année, les Acadiens sont autorisés à
revenir en Nouvelle Ecosse (c’est devenu
le nom de la Nouvelle France). Les uns
s’établissent sur la Côte rocailleuses
et peu fertile de la Baie Ste Marie,
bien différente des terres fertiles
qu’on leur a volées.
(A cet
endroit et une douzaine d’autres
villages demeure encore aujourd’hui un
bastion important de la culture
acadienne.)
Les
toponymes francophones seront
officiellement anglicisés, alors que les
Acadiens continuent à utiliser les
anciennes appellations françaises.
Mais la
majorité des Acadiens se rendent en
Louisiane, en Martinique ou en
République Dominicaine, et surtout
dans la province de Québec.
 En
décembre 2003, la gouverneure générale
Adrienne Clarkson a reconnu le drame
humain de la déportation, mais sans
offrir d'excuses formelles. Depuis, le
28 juillet est un jour de commémoration
de l'événement. En
décembre 2003, la gouverneure générale
Adrienne Clarkson a reconnu le drame
humain de la déportation, mais sans
offrir d'excuses formelles. Depuis, le
28 juillet est un jour de commémoration
de l'événement.
Il reste
encore en France des descendants des
Acadiens, qui connaissent bien
l’histoire de leurs aïeux.
* * * * * * * * *
«Les Acadiens sont
un peuple, et un peuple est plus fort
qu'un Pays. Un Pays est une institution,
mais un peuple est plus fort qu'une
institution, car il a une âme, il a des
rêves, il est vivant....»
(Antonine Maillet)
ACADIENS ET
ARMENIENS
Le Festival
Arménien de Moncton a pour but
de promouvoir la culture arménienne dans
la grande région de Moncton. Il a été
initié par des membres de
l’Association arménienne des Maritimes,
association importante qui regroupe plus
de 200 familles dans les provinces
Maritimes. A chaque édition, le Festival
Arménien propose un voyage qui emmène le
public des origines de la grande «
Arménie historique » à la découverte de
l’actuelle république d’Arménie et à la
grande diaspora arménienne dans le
monde. Aborder la diversité et la
vivacité d’une culture qui aurait pu
être anéantie par le premier génocide du
XXe siècle, faire le lien
entre ici et là-bas, issus de la
diaspora ou natifs d’Arménie, sur les
chemins de racines communes, entre hier
et demain… mais aussi permettre aux
communautés locales de découvrir et de
s’approprier l’histoire dense et
tourmentée, dont témoigne
l’exceptionnelle richesse du patrimoine
arménien vieux de plus de 2000 ans.
La 3ème
édition du festival de Moncton en
novembre 2009
Chaque édition met
en valeur un aspect ou événement plus
particulier de la culture arménienne.
Cette 3e édition du festival
fut dédiée à Komitas,
entre autres, compositeur, ethnographe,
folkloriste, musicologue, poète
arménien. A l’occasion de la célébration
de son 140e anniversaire de
naissance, le public était convié à
découvrir la vie, l’œuvre, le grand
éventail d’activités de ce compositeur
unique en son genre qui a eu un impact
important dans l’art musical arménien et
qui représente l’une de ses plus
illustres figures. Komitas se démarque
aussi des autres compositeurs du XXe
siècle. On dit que c’est un précurseur
de Bartok.
La 3ème
édition du festival de Moncton en
novembre 2009 a proposé plus de 4 jours
d’activités et de découvertes du monde
de Komitas : 3 expositions, 2 concerts,
un vernissage spectacle, un mini
festival de film, des conférences et
classe de maître à l’Université de
Moncton, des interventions dans les
écoles des districts 01 et 02, … de la
musique, du chant, de la danse, des
contes, des dégustations, autant de
regards sensibles pour comprendre,
partager et transmettre!
Sylvia Kasparian
Directrice artistique et présidente
Festival Arménien de Moncton
|